Sommaire

Préambule
1. Révolution Économique : des temps de retour accélérés
2. Performances Techniques : L’ére des hauts rendements
3. Contraintes Réglementaires : La fin des gaz fluorés
4. Évolutions Technologiques : L’intelligence au service du froid
5. Récupération de Chaleur : Une obligation légale et une ressource stratégique
Introduction
Inauguré courant de l’année 1983, le Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye de Seraing compte 374 lits d’hospitalisation et 30 lits en Maison de Repos et de Soins (MRS). Un édifice de quelques 50 000 m² répartis sur 10 niveaux dont la gestion technique et les études de projets sont assurés par une équipe d’une quarantaine de personnes.
Les besoins en froid
En deux décennies, l’hôpital a vu ses besoins en climatisation fortement augmenter et son réseau d’eau glacée multiplié au moins par 10. Les besoins en frigories sont passés d’une puissance d’environ 100 kW à l’origine à quelques 1 000 kW aujourd’hui. Une croissance qui s’explique par la présence d’équipements qui n’étaient pas aussi importants à l’époque que ceux que l’on rencontre de nos jours (scanners, résonance magnétique nucléaire, salle de coronarographie, …) mais aussi par la tendance actuelle à climatiser également les bureaux et l’ensemble des chambres.
Et en hiver, on climatise ?
Dans un hôpital, les besoins en frigories sont importants même en hiver notamment pour les blocs opératoires, les salles informatiques, les salles accueillants des équipements énergivores ainsi que les salles de consultations. Dans le cas du Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye, les 2 niveaux enterrés du bâtiment ont besoin d’être climatisés constamment toute l’année en raison notamment de l’éclairage permanent, des équipements présents et du personnel en nombre qui y travaille. Il faut souligner que ces 2 niveaux totalisent 20 000 m² soit 40% de la surface totale de l’hôpital.
Les installations frigorifiques
Les besoins frigorifiques de pointe actuels nécessitent de l’ordre de 200 m³/h d’eau glacée à 7°C. Cette dernière est produite à partir de 2 groupes de froid de 400 kW chacun et d’un groupe supplémentaire de 200 kW. Depuis la fin des années ’80, dans un souci d’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (URE) et donc d’économie financière, on pratique le principe du free-chilling et de la récupération de chaleur sur les groupes frigorifiques.
Principes du free-chiling

Lorsque la température extérieure descend sous les 8 à 10°C, on peut fabriquer de l’eau glacée sans utiliser le groupe frigorifique. L’eau est directement refroidie par l’air extérieur et la machine frigorifique est mise à l’arrêt. L’économie d’énergie est évidente ! La rentabilité du projet est d’autant plus élevée que les besoins de refroidissement sont importants en hiver et que l’installation s’y prête.
Le responsable technique de l’hôpital, conscient que des besoins de froid existaient durant toute l’année, donc également pendant l’hiver, profita de la rénovation d’une tour de refroidissement pour adopter la technique du free-chilling sur le circuit d’eau glacée. Il adapta la régulation pour permettre le fonctionnement sous deux régimes de température différents au niveau des tours de refroidissement : soit à moins de 10°C en mode free-chilling, soit à 40°C en été qui correspond à la température de sortie au niveau des condenseurs des groupes frigorifiques. Il favorisa également le refroidissement nocturne des locaux, ce qui ne crée pas d’inconfort pour les occupants, et valorise mieux le free-chilling puisque la température extérieure est plus basse la nuit.
En l’absence de mesures, voici une estimation de l’économie réalisée par l’arrêt du groupe frigorifique de 400 kW. Si le fichier météo de Uccle annonce 3 550 heures sous les 8°C, on peut estimer que le refroidissement effectif se fait durant 2 000 heures. Sur base d’un COP (COefficient de Performance) moyen de 2,5, c’est donc 160 kW électriques qui sont évités au compresseur. Une consommation supplémentaire de 5 kW est observée pour le pompage de l’eau au travers de l’échangeur et dans la tour. Soit un gain de 155 kW durant 2000 heures ou encore 310 000 kWh. Le temps de retour simple calculé à l’époque était de l’ordre de 3 à 4 ans pour un investissement total de 60.000 € dont la moitié pour la tour fermée de 360 kW et le reste en tuyauteries, régulation et génie civil.
On soulignera qu’adapter cette technique à une installation existante nécessite toujours une étude particulière (cadastre des énergies de froids consommées avec leur niveau de température, répartition été/hiver…) pour apprécier la rentabilité.
La récupération de chaleur
Le groupe frigorifique de 200 kW fonctionne prioritairement par rapport aux 2 autres et est sollicité toute l’année durant. Lors de son acquisition, l’équipe technique a opté pour un groupe fonctionnant avec une température au condenseur plus élevée de l’ordre de 45 à 50°C. L’idée dès le départ était de récupérer la chaleur libérée au condenseur pour chauffer l’eau de la piscine de l’hôpital ainsi que l’eau chaude sanitaire dont la consommation journalière est d’environ 30 m³ à 50°C. Ce sont quelques 70 kW thermiques en moyenne qui sont ainsi récupérés et non pas offerts aux petits oiseaux via les tours de refroidissement situées en toiture. Une économie annuelle en gaz de l’ordre de 70.000 m³.
En détail
René TILLIEUX
Directeur technique
Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye
Tél : 04/338.78.80
Cette étude de cas provient des Sucess Stories réalisées par l’ICEDD, Institut de conseils et d’études en développement durable en 2004.


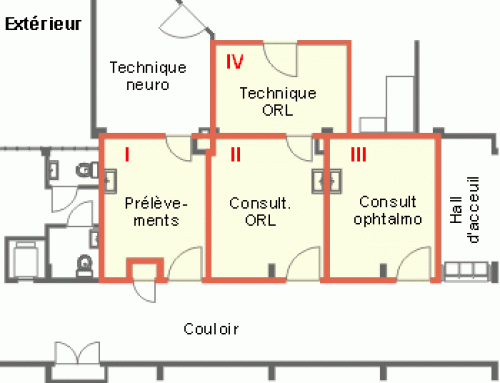
Auteur : les anciens
Mars 2009 : Thibaud
Notes :