Sommaire

Introduction
L’intermittence du chauffage est une stratégie de gestion énergétique consistant à adapter les périodes de fonctionnement du système de chauffage en fonction de l’occupation des locaux et des besoins réels en chaleur. Cette pratique, bien maîtrisée, permet de réaliser des économies d’énergie significatives tout en maintenant un niveau de confort acceptable pour les occupants.
Avec l’évolution des réglementations énergétiques et des technologies, comme les thermostats programmables, les systèmes de gestion technique des bâtiments (GTB) et la domotique, la mise en œuvre de l’intermittence est aujourd’hui plus précise et efficace. Ces outils permettent d’automatiser la réduction des températures pendant les périodes d’inoccupation et d’assurer une remontée rapide à une température de confort, limitant ainsi les pertes d’énergie inutiles.
Il convient également de prendre en compte les spécificités des générateurs modernes, notamment les chaudières à condensation et les pompes à chaleur, dont le fonctionnement optimal est parfois conditionné à un régime de température constant. La stratégie d’intermittence doit donc être adaptée en fonction des équipements installés, de l’isolation thermique du bâtiment, de son inertie et des besoins d’occupation.
Cet article analyse les principes de l’intermittence du chauffage, ses avantages potentiels en termes d’économies d’énergie, ainsi que les conditions techniques et réglementaires nécessaires à son efficacité dans le contexte des bâtiments actuels.
Image de l’économie : la température intérieure
La consommation d’une installation de chauffage est proportionnelle à la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur. Plus cette différence diminue, moins on consommera.Graphiquement, on peut représenter la consommation de chauffage comme suit :
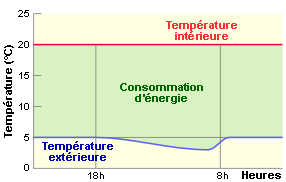
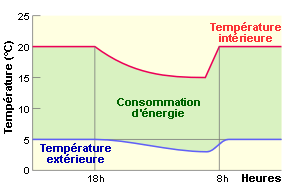
Image de la consommation de chauffage sans intermittence et avec intermittence.
On voit donc que plus la température intérieure chute et plus le temps pendant lequel cette température est basse est important, plus l’économie d’énergie réalisée grâce à l’intermittence est importante.
Paramètres influençant l’économie
Si l’installation est coupée la nuit et le week-end, quelles seront les économies engendrées ? La figure ci-dessous résume les différents paramètres qui influencent le bilan thermique.
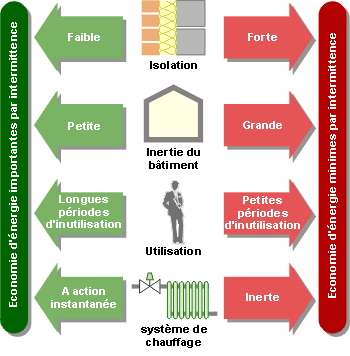
L’économie est fonction du degré d’isolation
Plus le bâtiment est isolé, moins la chaleur emmagasinée s’échappera et plus la température intérieure restera stable lors de la coupure du chauffage. L’économie réalisée sera faible.
Au contraire, lorsque le chauffage est coupé dans un bâtiment peu isolé (des façades très vitrées, par exemple, avec des infiltrations d’air importantes)), la température intérieure chute rapidement. C’est dans ce genre de bâtiment “passoire” que le placement d’un régulateur-programmateur sera le plus rentable.
L’économie est fonction de l’inertie de bâtiment
Imaginons un local très lourd, très inerte (anciennes constructions massives) : la température intérieure chutera peu durant la coupure de nuit, car beaucoup de chaleur s’est accumulée dans les murs. Les économies seront faibles… . Par exemple, il ne sert à rien de placer un optimiseur dans un château fort.
Par contre, si le bâtiment est du type préfabriqué, fait de poutrelles et de cloisons légères : dès que le chauffage s’arrêtera, la température chutera. Dans ce cas, la consommation est pratiquement proportionnelle à l’horaire de chauffe. C’est l’exemple de la voiture qui monte rapidement en température dès l’apparition du soleil et qui se refroidit très vite aussi dès que l’on coupe le chauffage.
L’économie est fonction de la durée de coupure
Une coupure d’un week-end est beaucoup plus efficace qu’une coupure nocturne. La coupure sur le temps de midi est sans intérêt.
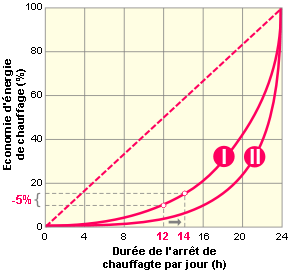 |
|
Économie d’énergie suite à un abaissement nocturne pour différents types de bâtiments en fonction de la durée de l’arrêt de chauffage. Le pourcentage d’économie se rapporte à un chauffage permanent. |
Par exemple, une interruption du chauffage de 12 heures génère 11 % d’économie dans un bâtiment de construction légère (faible inertie thermique). On gagne encore 5% si on coupe 2 heures de plus. |
Source : Staefa Control. |
L’économie est fonction du sur-dimensionnement de l’installation de chauffage
Si l’installation est très puissante (chaudière et radiateurs surdimensionnés), la relance du matin pourra se faire en dernière minute. Et donc la température intérieure de nuit pourra être plus faible.
Si l’installation est dimensionnée au plus juste, par les plus grands froids, il sera impossible de couper l’installation la nuit, sous peine de ne pouvoir assurer le confort au matin. Aucune économie ne sera possible.
L’économie est fonction du type d’installation de chauffage
Si le chauffage est assuré par un système à air chaud (chauffage très peu inerte), la mise en régime et l’arrêt du chauffage sont immédiats. Si l’installation est réalisée par un système de chauffage par le sol (chauffage très inerte), les temps de réponse seront forts longs et l’intermittence n’est guère envisageable …
Exemple
| Exemple.
(Source : “Guide pour la pratique de l’Intermittence du chauffage dans le tertiaire à occupation discontinue”, ADEME, 1989) Trois bâtiments, respectivement de 500 (1 niveau), 2 000 (2 niveaux) et 4 000 m² (4 niveaux) sont chauffés 10 h par jour et 5 jours par semaine. Le niveau de surpuissance de l’installation de chauffage est assez élevé puisqu’il atteint 2 fois les déperditions (calculées avec un taux de ventilation réduit). Trois niveaux d’isolation ont été repris :
Trois modes de coupure sont proposés :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de consigne
Le gain énergétique provient de la diminution des déperditions nocturnes. Et donc, plus la température intérieure descendra, plus l’économie augmentera. Il ne faut pas descendre sous une température de 12°C, parce que :
- Cette température correspond au point de rosée de l’ambiance et que des problèmes de condensation pourraient se poser.
- Malgré la relance du lundi matin, la température des murs serait trop froide et engendrerait de l’inconfort pour les occupants.
- Maintenir 12°C dans le local témoin (où se trouve la sonde de régulation), c’est maintenir l’ensemble du bâtiment hors gel.
Une consigne de 16°C durant la nuit (voire moins) et 14°C durant les week-ends et les périodes scolaires est donc recommandée.
Il faut en outre savoir que cette température de consigne ne sera que rarement atteinte (uniquement en plein hiver), ce du fait de l’inertie thermique du bâtiment qui ralentit la chute de température.
Conclusion
La gestion intermittente du chauffage représente une solution efficace pour réduire la consommation énergétique des bâtiments, en particulier lorsqu’elle est combinée à des systèmes de régulation modernes et à une bonne isolation thermique. Elle permet d’adapter la production de chaleur aux périodes d’occupation réelles, limitant ainsi les gaspillages tout en assurant le confort des usagers.
Toutefois, cette stratégie doit être pensée en fonction des caractéristiques techniques du bâtiment et des équipements installés. Les chaudières à condensation et les pompes à chaleur, par exemple, requièrent une gestion spécifique pour maintenir leur efficacité optimale.
Dans un contexte réglementaire de plus en plus exigeant et face aux enjeux de la transition énergétique, l’intermittence du chauffage constitue une démarche complémentaire aux actions d’isolation et à l’intégration de systèmes énergétiques performants. Elle s’inscrit pleinement dans les objectifs de réduction des consommations d’énergie et d’amélioration de la performance environnementale des bâtiments.


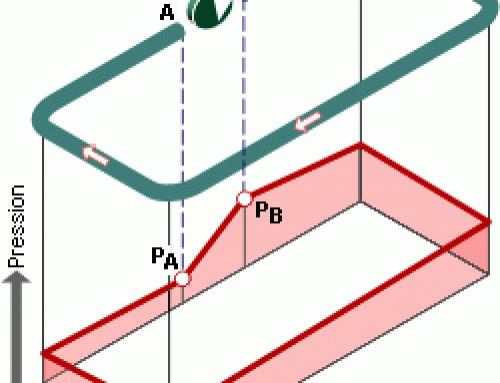

Auteur : les anciens
Eté 2008 : Brieuc.
Notes : 06.02.09
[…] ÉnergiePlus, une coupure nocturne bien pilotée permet jusqu’à 11 % d’économies annuelles, même dans […]